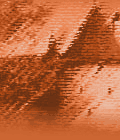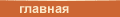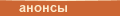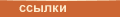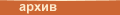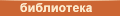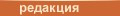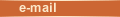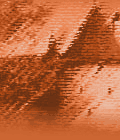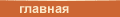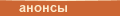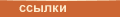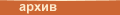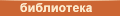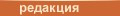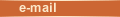Alain BLUM
PARADOXE
Comme l’ont souligné les intervenants précédents, nous sommes
aujourd’hui en présence de récits nationaux reconstruits pour
conforter des nouveaux États, mais aussi une histoire qui se reconstruit
suivant une période d’ignorance ou de négation qui a duré
jusqu’au début des années 1980. C’est la combinaison de ces deux
dimensions, réécriture indispensable d’une histoire du 20ème
siècle où l’URSS a une place centrale, et
réécriture de cette histoire de points de vue divergents, tenant
à cette réécriture d’une histoire nationale, qui provoque
ces débats. Elle conduit à un déploiement
législatif nouveau dans toute l’Europe, une judiciarisation du
récit historique que Pierre Nora a qualifié à juste titre
de dérive (pensons au débat sur le communisme en Union
européenne, dont la dimension historique qui conduit à
mêler stalinisme, communisme, et bien d’autres concepts, sans grand
discernement historique). Elle conduit aussi, il faut le souligner, à ce
développement des Instituts de la mémoire nationale, dans de
nombreux pays d’Europe centrale et orientale, aux statuts parfois complexes,
à la marge entre historien et politique.
L’historien d’où il soit, surtout l’historien du 20ème
siècle mais pas seulement, est désormais face à cette
difficile et contradictoire réécriture de l’histoire de l’Europe
(essentiellement). C’est sans aucun doute devant ce passionnant objectif, que
nous devons poser la question de la relation entre histoire, historien et
pouvoir. Elle se pose ici, en Russie, elle se pose comme rarement en France,
ailleurs, montrant que cette question de la relation n’est pas propre à
la Russie.
Je parlerai ainsi d’une part en tant qu’historien de la
Russie et de l’URSS, qui porte ainsi un regard sur le travail
historien en Russie, sur les relations entre histoire et pouvoir dans ce pays,
mais que je soulève aussi en tant qu’historien français, qui
réagit, dans son propre pays aux débats sur les relations entre
monde politique et travail scientifique, sur l’usage politique de l’histoire,
qu’a souligné Pierre Nora, désormais bien trop fréquent,
sur l’instrumentalisation de l’histoire.
(ce pseudo débat sur l’identité nationale, où le politique exige
presque que les scientifiques participent à un débat que ces
derniers rejettent et n’ont pas suscité. en est un exemple)
On est donc ici au cœur de l’autonomie du travail scientifique, et de sa relation avec la
sphère publique, avec la société.
Je souhaiterai d’abord souligner un paradoxe russe, que la mise en parallèle des
interventions de Pierre Nora et Valerij Tishkov montre bien :
D’un côté une relation que je qualifierai de déroutante, de
particulière, entre l’histoire et le politique, entre l’historien et
l’état, qui conduit l’historien à participer directement à
la constitution d’un discours sur la nation, à la construction de la
mémoire nationale, en établissant des relations
particulières avec le monde politique.
Du même côté, un accès aux archives, cœur de
l’élaboration du travail historien, qui reste soumis à beaucoup
d’arbitraire, qui a eu tendance à
se restreindre, qui laisse penser que seuls certains peuvent avoir accès
à certains fonds, s’ils sont en cour auprès de telles ou telles
institutions, qui laissent des fonds entiers d’archives fermés ou
à accès réservés, alors que la loi sur les archives
devrait permettre d’y avoir librement accès.
Enfin, de cet étrange dimension du travail historien, je retiendrai aussi cette
élaboration d’une histoire nationale publique à travers la
publication de manuels ou autres ouvrages destinés à un large
public, faite par les historiens, en contradiction presque totale avec le
travail historien mené dans le monde entier, pour écrire ou
réécrire l’histoire de ce pays, l’histoire du 20ème
siècle en général.
Comme si une partie de la communauté historienne de Russie,
pensait pouvoir développer une approche historique isolée du
reste du monde, ne faisant guère écho au récit historique
désormais largement admis ailleurs.
D’un autre côté, un dynamisme de la recherche historique, menée en des
lieux très divers par des historiens reconnus internationalement, qui
est révélé par la multitude des publications, des articles
dans de nombreuses revues, de polémiques intéressantes
menées dans le cercle des historiens. (Même si comme l’a
souligné Valerij Tishkov, se développe toute une
littérature para-historique. Ici,
à nouveau, il me semble que la question de la reconnaissance
internationale est fondamentale comme critère de sérieux,
au-delà de la reconnaissance par la communauté nationale des
historiens.). Ce dynamisme se voit par une activité
éditoriale unique. Qui pourrait en France imaginer la publication d’une centaines
d’ouvrages sur l’histoire d’une de ses pages douloureuses, comme cela se fait
en Russie sur l’histoire du stalinisme (Rosspen) ? Qui pourrait
penser que se développeraient autant de débat au sein de
plusieurs revues, sur tel ou tel aspect de l’histoire du 19ème
siècle, de la Révolution, du stalinisme?
Il me semble que ces contradictions ne peuvent être éclaircies sans affirmer un certain
nombre de principes qui doivent sous-tendre le travail historien et ses
relations avec le politique.
Je les évoquerai en trois points:
1. Une communauté historienne internationale, qui conduit à élargir l’histoire nationale et surtout à la dégager des contraintes politiques.
2. Une large ouverture des sources.
3. Poser différemment les questions de l’implication du pouvoir, des hommes et femmes dans les drames du 20ème siècle.
4. La place de l’historien et de sa relation avec le politique.
1. Il est impossible de formuler une seule vérité historique, d’autant plus que les
représentations de l’histoire les conclusions des historiens sont
changeantes, avec le temps et avec le point de vue porté. Il n’est donc
pas question de « dire le vrai », mais seulement de le mettre en
débat ; Le travail historien ne peut se développer qu’en
acceptant, et même en suscitant le débat et la polémique,
d’abord au sein de la communauté historienne, mais aussi en rendant
public ces polémiques et débats. Ils doivent
impérativement avoir un caractère international. Car le travail
historien n’est fécond que s’il accepte de dépasser les
frontières nationales et accepte l’idée qu’il n’y a pas de primat
de l’historien national pour constituer une histoire nationale.
Une histoire nationale ne peut se constituer qu’au croisement de regards historiens qui
viennent de lieux divers. Je rappelle ainsi que l’histoire de plusieurs pages
douloureuses de l’histoire de France, comme l’histoire de la colonisation, de
la guerre d’Algérie, de Vichy, ont été dynamisé, a
été modifié à l’incitation d’historien non
français.
Je rappelle aussi que dans leurs relations avec le monde politique, les historiens français,
réagissant aux lois mémorielles qu’ils ont perçues comme
mettant en cause leur travail, dont a parlé Pierre Nora, ont largement
fait appel à des collègues étrangers. J’ai toujours
été étonné de d’entendre en Russie, assez souvent,
un discours qui parle d’ingérence de l’historien français,
allemand ou américain dans la constitution de leur histoire nationale.
C’est au contraire salvateur, seul moyen d’écrire une histoire
partagée.
2. Mais cela signifie, deuxième principe essentiel, un accès aux archives
très ouverts, qui donne à tous le même accès, qui ne
soit pas fondé sur des privilèges ou des accès
arbitraires, et qui donne aux archivistes et aux historiens un rôle
essentiel dans l’accès aux fonds. Cela ne signifie pas que des règles
de protections de l’individu ne soient pas respectées, mais, dans le
respect de lois qui soient ouvertes, c’est aux archivistes et historiens de donner
accès aux fonds. Cela signifie aussi, me semble-t-il, que le
régime légal d’accès doit tenir compte du caractère
exceptionnel du stalinisme, et donc en élargir l’accès
au-delà des limites usuelles. Seule une pression unanime des historiens
peut pousser à cela. En France, les historiens se sont battus, se
battent pour élargir l’accès aux archives des années de
décolonisation. Je suis frappé de voir à quel point des
débats comme ceux sur la famine de 1933 sont souvent limités par
des accès très différents aux archives en Russie, encore
difficile, ou en Ukraine, où tout est disponible.
3. L’historien doit s’efforcer, aujourd’hui, de reposer la question de la responsabilité, de
la collaboration ou la résistance, de l’adhésion, de la
participation, des victimes et des bourreaux, aux drames exceptionnels du 20ème
siècle. L’historien qualifie les faits, les nomme. Il doit cependant se
dégager de qualification simplificatrice dont le seul but est de
condamner ce qui, de toute façon, est condamnable. Personnellement, je
n’aime pas le débat sur la question du « génocide » de
1933, car il ne porte que sur une qualification, qui plus est a une dimension
juridique… Mais j’attends aussi que toutes les archives présidentielles
et du NKVD en Russie soient ouvertes à tous, pour mieux discuter avec
les Ukrainiens et sortir d’un dialogue de sourds.
L’historien et le pouvoir, l’historien et la mémoire
Ici j’en viens au dernier point, cette relation particulière entre historien et pouvoir et
la contribution de l’historien à l’élaboration d’une
mémoire nationale. Personnellement j’estime qu’un historien ne doit pas
participer à une commission quelconque, créée par l’Etat,
pour dire le vrai. Il peut être entendu par des commissions
parlementaires, mais ne peut établir de lien de dépendances ou
d’influences directes sur l’Etat. La séparation doit être claire,
entre ceux qui prennent des lois et ceux qui sont des scientifiques.
L’historien doit préserver à tout prix son autonomie, et doit
apporter de l’influence en ouvrant justement largement le débat public.
Que ce soit en Russie, avec cette commission sur la falsification que je
réprouve car elle suppose de dire le vrai, que ce soit en France,
lorsque l’Etat cherche à faire participer historiens ou autres
scientifiques à la formulation de ce que serait l’identité
nationale, ce type de relations me semble devoir être proscrit.
Nous parlerons cet après-midi de l’historien et la mémoire historique, ce qui
permettra d’aller plus profondément sur cette question.
[De la même manière, l’historien n’est pas porteur de la
mémoire nationale (Ce sera le thème de la première
séance de l’après-midi). Il doit rester à distance de tout
ce qui porte sur la mémoire nationale. Bien entendu, son travail y
contribue, mais par l’appropriation qui peut en être faite par la
société. Il peut réagir, il écrit partiellement en
fonction du développement de récits historiques portés par
le politique ou la société, puisqu’il est inscrit dans le
débat public, mais il doit garder une distance suffisante.
Les sirènes du pouvoir sont trop fréquentes, en Russie
autant qu’en France ou qu’ailleurs, pour ne pas résister au maximum
contre elles.]
|
 |
 |